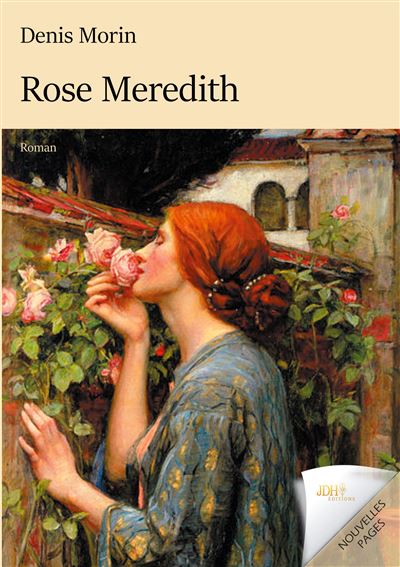ROSE MEREDITH (Denis Morin)
Tu sais, les années passent et tout est porteur de souvenirs, qu’on le veuille ou non.
(p. 133)
.
YSENGRIMUS — Le roman de type fresque familiale est un genre à part. On pense au Père Goriot, à Jalna et même à la bande dessinée Persépolis. L’écrivain Denis Morin va nous convier à renouveler, en sa compagnie, ce genre dense et séculaire, ayant une très solide présence dans les cultures anglaise et française. Mais Morin, serein, n’est pas un romancier du temps de Balzac ou de Mazo de la Roche. Sans s’en soucier particulièrement, il fait face à une compétition féroce qui est celle de nul autre que du grand feuilleton télé. Aujourd’hui, la fresque familiale, la comédie humaine et tout le bazar du même acabit, ce sont Les Soprano et Les Pays d’en haut qui nous les livrent. La saga des grandes et des petites familles, elle n’est plus livresque ou journalistique. Elle est visuelle.
L’invitation implicite que nous fait donc Denis Morin est avant tout celle de l’accompagner dans un exercice d’écriture que retravaille en profondeur à la fois les contraintes d’un héritage et la facture textuelle d’un genre. À notre chère fresque familiale, Morin va faire subir un discret rafraichissement moderniste. D’abord, il va radicalement l’abréger. Il va la segmenter, la tronquer même, sans pour autant la raccourcir. Pour ce faire, il va la lisser. Là où Balzac et de la Roche opéraient sur des centaines et des centaines de pages, Morin va confortablement nous caser, en deux petites parties (une première de 104 pages, une seconde de 40 pages), soixante ans de récit. Pour ce faire, il va procéder par grandes fiches chronologiques. Un lieu, une date, un segment de récit. Ensuite un autre lieu, une autre date (trois mois ou même trois ans plus tard) et une autre portion du récit. Là, où la fresque familiale classique aurait tout rapporté méticuleusement, par le menu, sur des kilos de texte, Morin lisse le récit, il le survole, le synthétise, le rapporte sans trop le relater, concentrant son attention sur les points nodaux chargés de gravité, de densité et de langueur. Denis Morin procède sciemment avec son récit comme on le fait, semi-consciemment, avec nos souvenirs de vie. C’est presque une sorte de psychologie de la fresque, cet exercice, en fait.
Autre manifestation de modernité du procédé: Morin renonce très méthodiquement au suspense. Il n’y a pas d’effet à la roman policier ici, pas de rebondissements surprises. Nous sommes dans du cursif, du factuel, du froidement évènementiel. Le tout se joue en cultivant une subtile proximité avec le journal intime, le compte-rendu journalistique à l’ancienne ou encore le récit de mémorialiste. On est avec ces types textuels bien plus qu’avec les polars ou les romans d’aventures à péripéties. Et pourtant, mes amis, oh, oh, il s’en passe, des choses… C’est le ton qui nous repose des effets de suspense plus que les segments de contenu en tant que tels, qui, eux, y sont, incontestablement. Morin pousse la distanciation (au sens brechtien du terme) face au suspense jusqu’à nous fournir, en ouverture, un arbre généalogique synthétique du dispositif familial qu’il expose. Dès le début des courses, donc, on sait que Violet et Meredith épouseront le même homme et ce, fort probablement en séquence (ou autrement). Nous ne sommes pas vraiment ici pour nous faire surprendre mais plutôt pour nous faire émouvoir.
En bon auteur contemporain bon teint, connaissant solidement et dominant librement ses ressources, Morin exploite les interfaces de genres avec astuce, souplesse et bonheur. Ainsi, il n’hésite pas à nous présenter, en ouverture, une description physique et psychologique sommaire de sa douzaine de personnages, un peu comme cela se fait, par exemple, dans l’espace présentoir d’une pièce de théâtre ou d’un livret d’opéra. Les fiches chronologiques, déjà mentionnées, rédigées en caractères droits, sont séparées les unes des autres par des notules intimistes rédigées, elles, en caractères italiques. Ces segments-là, procédant du journal intime, du discours intérieur ou du texte épistolaire, ont pour fonction de nous faire découvrir les pensées secrètes ou privées de chacun des protagonistes et ce, en alternance. On notera qu’aux fins de la présente recension, je ne respecte pas ce codage des caractères (car ici, tout ce qui est cité du roman de Morin est en caractères italiques). De façon très libre, notre chroniqueur de fresque familiale assume son temps. Il n’hésite pas à mobiliser le contact harmonieux de genres littéraires que les vieux faiseurs de fresques maintenaient soigneusement séparés. Morin sert les priorités de la tonalité de son récit avant de servir ce récit lui-même. Présentation d’évènements-forces en réduisant au minimum les effets de suspense, alternance méthodique entre le contenu factuel et le contenu intimiste, succession comme en diapositives de fiches chronologiques permettant de lisser plus de soixante années de vie et de successions généalogiques en moins de 160 pages.
Ceci dit et bien dit, bon, que se passe-t-il tant dans cette fresque familiale de Denis Morin? Je ne vais certainement pas tout vous livrer car il faut lire. Mais pourquoi ne pas vous en concéder un petit bout. Je pense à la toute succincte version que les protagonistes se transmettent justement entre eux. Ici, c’est Florence Beauchamp, la petite-fille du couple d’origine, qui parle:
Je me lance. Il était une fois une jolie Irlandaise catholique née O’Sullivan qui fut reniée par les siens, car ayant épousé un bel Écossais, un Byrne anglican. Les deux s’installèrent à Glasgow. Puis vinrent au monde les jumelles, la méchante Violet, mère du peintre ici présent, qui se suicida, et la douce Meredith, ma mère, On suit la parade jusqu’à présent. (p. 139)
La parade en question se déploie donc entre 1938 et 1998. Sur soixante ans et trois générations, on survole, en frémissant, les aléas, les hauts et les bas de cette douzaine de vies. Il y a ce qui est coulant et il y a ce qui est saillant. Parfois, c’est quand le visible devient illisible et que les accidents surviennent que l’émotion et la beauté sont au rendez-vous (p. 135). Le principe-clef du déploiement social évoqué réside dans le fait que le rapport des classes entre maitres et valets s’inverse. Matthew Byrne, négociant écossais qui initialement fait de l’import-export de laine avec le continent, se retrouve subitement ruiné par une conjoncture aussi foireuse que mal élucidée. La femme de chambre de sa famille, au même moment, hérite for opinément de propriétés foncières, notamment au Canada. Elle devient donc plus ou moins la dynamo économique et la garante de survie de ses anciens maitres, désormais déclassés. Tout démarre de cette façon, lors du passage de l’Ancien monde au Nouveau. Ce qui, pour Balzac, aurait apparu comme un drame central et passablement tonitruant est traité ici avec la sérénité, la sobriété et la légèreté du regard moderne et contemporain de Morin. Son dispositif présentoir est ouvertement rétrospectif. Il expose donc ces drames familiaux, sans nécessairement en partager les effusions. L’accession sociale de Mademoiselle Marguerite se fera sans tambour ni trompette. L’ancienne domestique devenue propriétaire foncière et dame-fermière aura ce mot, suave, au cours d’un de ses épanchements intimistes: Je me sens parfois tel un oignon, je me sens tantôt bulbe de tulipe. Comme Madame Byrne, j’ai toujours préféré la beauté des fleurs aux larmoiements de cuisine en retirant les pelures (p. 27). Pas plus folle qu’une autre, entre le pain sec et le pain frais, pourquoi ne pas mordre dans le pain frais, si une soudaine conjoncture historique l’autorise. L’accession sociale n’est pas une transgression. Elle pourrait même envisager de se faire en relative harmonie avec les ci-devant anciens maitres. L’inversion des rapports de classes est tout juste une séquence à peine raboteuse, dans le récit lisse et luisant d’un Denis Morin. Réaliste? Pas certain. Moderniste, en tout cas.
Je ne vous en dis pas plus. Il faut lire et prendre la mesure de la mutation stylistique insolite que Denis Morin impose calmement à un bon vieux genre bien de chez nous. Cet écrivain sait ce qu’il fait. De fait, cet artiste comprend solidement les arts. Je trouve intellectuellement reposant de tomber sur quelqu’un qui, au beau milieu de tout et du reste, nous laisse découvrir qu’il comprend adéquatement la peinture. J’en veux pour preuve ce tout petit moment automnal: Les arbres de la région se sont chargés d’or, de cuivre et de feu. Charles-Mathieu décrit durant le trajet ce décor automnal à Jérémie qui lui traduit les images que cela donne dans sa tête. Ils en feront des tableaux abstraits, à grands jets de couleurs (pp 142-143). Ah, enfin quelqu’un qui comprend que la peinture abstraite n’est pas la séparation du figuratif mais son émanation. Charles-Mathieu, vous avez un style qui part du figuratif pour aller vers l’abstrait, alors que votre neveu est dans l’art naïf, classifie Hugo (p. 137). Voilà, oui. Grand merci, Hugo.
Nous sommes donc dans du roman réaliste mais au traitement solidement teinté de modernité, dans des récits concrets mais qui ne se gênent pas pour laisser une place honorable au surnaturel, dans un travail de chroniqueur mémorialiste qui ne craint ni les raccourcis ni la liberté contemporaine de l’analyse, et finalement dans une littérature du terroir qui se définit intrinsèquement dans une dimension sereinement et constitutivement internationale.
En lisant ce roman, j’ai souvent eu le sentiment de tenir entre mes mains une sorte de synopsis soigneusement amplifié, une manière de script de film n’attendant plus que la caméra. Denis Morin écrit dans un style sobre, adéquatement élagué, toujours tranquille. Des roses greffées mais qui ne débordent pas de leur roseraie. Et, aussi, on a ici une honorable lecture de confinement et de déconfinement… Indubitablement… Or, il est un temps pour coudre et confiner, puis il est un temps pour libérer et en découdre (p. 148).
.
Denis Morin, Rose Meredith, JDH Éditions, coll. Nouvelles Pages, 2020, 158 p.
.